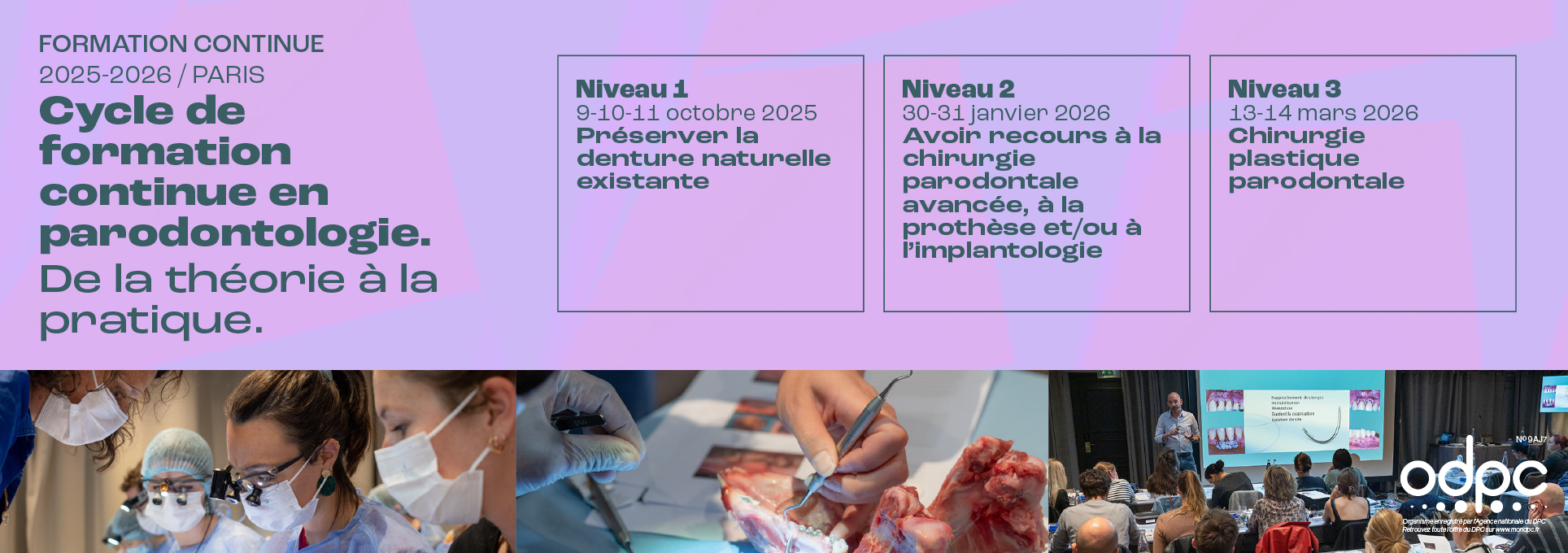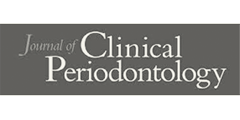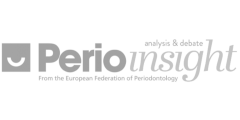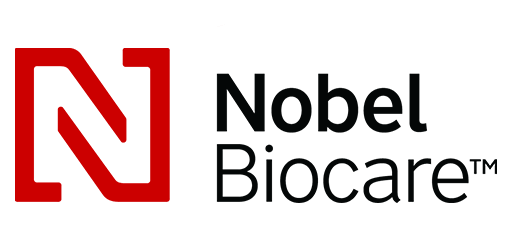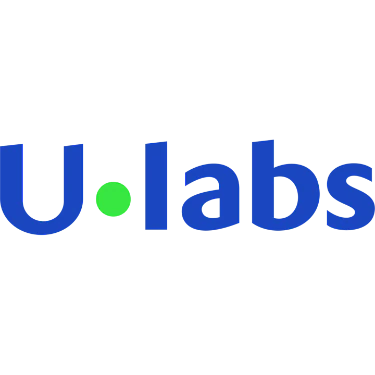Les maladies parodontales, c’est quoi ?
Les maladies parodontales sont des maladies inflammatoires multifactorielles d’origine bactérienne. Celles-ci touchent le parodonte qui peut se définir comme l’ensemble des tissus de soutien
 Cette agression bactérienne est la résultante d’une accumulation de bactéries sous forme de plaque dentaire au contact du sillon gingivo-dentaire : elle constitue la cause principale des maladies parodontales. Selon la nature de la plaque bactérienne et selon l’importance des mécanismes de défense de l’organisme, il existe un équilibre hôte/bactéries (santé parodontale) ou une absence d’équilibre (maladies parodontale). Il est fondamental de comprendre qu’une maladie parodontale ne concerne rarement qu’une seule dent mais plutôt un ensemble de dents sinon toute. On distingue deux grands types de maladies parodontales : - la gingivite qui se traduit par une inflammation superficielle du parodonte sans perte d’attache de la gencive sur la dent. Elle est le plus souvent liée à une augmentation de la quantité de plaque bactérienne. Elle est réversible après élimination de cet excès de plaque. Cette forme superficielle de maladie parodontale touche environ 80% de la population. - la parodontite qui se traduit par une destruction des tissus de soutien de la dent : perte d’attache de la gencive sur la dent, formation d’une poche parodontale entre la gencive et la dent, destruction de l’os alvéolaire support de la dent et d’une altération du cément qui recouvre la racine dentaire. Cette forme de maladie parodontale est irréversible : les structures perdues ne peuvent être reconstruites que dans des cas très particuliers. Les parodontites regroupent diverses formes cliniques caractérisées par un degré d’atteinte (sévère, modérée, superficielle), un type de progression (chronique ou agressive), une localisation (localisée ou généralisée) et une flore bactérienne sous gingivale particulière. 27% environ de la population française de plus de 35 ans présente une forme modérée et 15% une forme sévère. Facteurs de risque ? Le tabac, le diabète et l’hérédité sont les 3 facteurs de risque principaux des maladies parodontales. Ils augmentent le risque de développer et/ou d’aggraver une maladie parodontale. Le manque de suivi, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, le stress, l’âge, l’état de santé générale, la consommation d’alcool sont aussi des facteurs qui peuvent intervenir sur cette maladie. Comment savoir si on est malade ? Les premiers signes cliniques de cette maladie sont : l’inflammation (rougeur et augmentation de volume de la gencive), l’œdème (gonflement), la présence de plaque visible à l’œil nu et le saignement lors du brossage accompagné d’une halitose (mauvaise haleine). L’évolution se fait par une exacerbation de ces signes avec en plus la formation de tartre (qui correspond à la calcification de la plaque dentaire) et l’apparition de récessions tissulaires (déchaussement des dents). Les dents deviennent mobiles par destruction des tissus de soutien pouvant aller jusqu’à la perte définitive de la dent. Certains signes cliniques comme le saignement peuvent être masqués chez les patients qui fument, ce qui l’amène généralement à consulter à un stade plus avancé lorsque les dents commencent à bouger. Le diagnostic précis d’une maladie parodontale se fait au cabinet dentaire chez un omnipraticien ou chez un parodontologiste. Le principal outil de diagnostic est une sonde parodontale qui permet d’évaluer la formation ou non de poche parodontale (espace entre la gencive et la dent) et le cas échéant sa profondeur. Cet examen n’est pas douloureux et permet d’emblée de poser un diagnostic différentiel entre santé parodontale, gingivite et parodontite. L’examen complémentaire de choix est un bilan radiographique (bilan rétro alvéolaire) qui permet d’évaluer la perte osseuse autour des dents (en cas de parodontite). Est-ce que les maladies parodontales ont des conséquences sur l’état de santé ? De nombreuses études scientifiques mettent aujourd’hui en rapport la santé parodontale et l’état de santé générale. Ainsi une mauvaise hygiène orale pourrait constituer un facteur de risque et/ou prédictif pour les maladies ischémiques coronariennes (infarctus du myocarde). Dans le même ordre d’idée, il semble que les maladies parodontales puissent influencer le contrôle métabolique du diabète de type 2. Enfin, il semble que les femmes enceintes souffrant d’une maladie parodontale présentent un risque accru de naissance prématurée ou d’enfant de petit poids Comment soigne t-on une maladie parodontale ? La prise en charge thérapeutique d’une maladie parodontale (gingivite et parodontite) implique le praticien et le patient. En effet, la première étape fondamentale de tout traitement parodontal reste l’apprentissage par le patient d’une méthode de brossage efficace utilisant un matériel adapté à chacun (prescrit par le praticien). Le rôle du patient est déterminant dans la mesure où sa méthode de brossage permet le maintien d’un niveau réduit de plaque dentaire qui va optimiser puis pérenniser le traitement réalisé au cabinet dentaire. Dans le cadre d’une gingivite, le traitement impliquera des détartrages au dessus de la gencive afin de supprimer le tartre et la plaque dentaire. Ce traitement permettra, en association avec l’amélioration par le patient de son hygiène orale, une réduction de la quantité de bactéries et une réduction de l’inflammation des gencives. Le nombre de séance dépendra du degré de sévérité initiale de la gingivite et de la qualité de la coopération du patient. Deux à trois mois après cette phase de traitement, le praticien effectuera une ré évaluation de la qualité de l’hygiène et de la réponse de la gencive au traitement et le patient pourra alors être placé dans un programme de suivi régulier afin d’éviter les récidives. Pour les parodontites, le traitement s’organisera de la manière suivante : - prescription de matériel d’hygiène et enseignement des techniques de brossage par le praticien - détartrage au dessus et en dessous de la gencive (sous anesthésie locale) afin de réduire les bactéries présentes sous la gencive. Cette phase de traitement peut être associée à des irrigations sous gingivales d’antiseptiques. Dans certaines situations avancées, une prescription d’antibiotiques peut suivre cette phase de traitement. - ré évaluation de la réponse au traitement et de la coopération du patient - en cas de persistance de poches profondes qui saignent lors du sondage, des interventions chirurgicales peuvent être envisagées pour réduire ces poches (dans certaines situations spécifiques, au cours de ces interventions, des techniques de reformation de l’os peuvent être envisagées). - la phase d’entretien ou de maintien correspond à des rendez vous de contrôle de l’hygiène, de détartrage et de surveillance de la maladie dont la fréquence sera fonction de la sévérité initiale de la maladie et du niveau d’hygiène orale du patient. Peut-on guérir d’une maladie parodontale ? Il est tout à fait possible de guérir d’une maladie parodontale dès lors que celle-ci a été convenablement prise en charge et dans la mesure où le patient s’astreint à respecter ses rendez vous de suivi et de contrôle. Dans les cas des parodontites, si la maladie peut être stoppée, la rétraction des gencives et la perte osseuse restent irréversibles. Les traitements parodontaux sont ils remboursés par la sécurité sociale ? Seules deux séances par an de détartrage au dessus de la gencive sont remboursées par les organismes de sécurité sociale. Le reste des soins comme l’enseignement à l’hygiène orale, les détartrages sous la gencive, les irrigations d’antiseptiques sous la gencive, les analyses de la flore bactérienne, les interventions chirurgicales sont hors nomenclature. Ils ne sont donc pas pris en charge par la sécurité sociale. Il appartient donc au dentiste de fournir un devis correspondant au traitement parodontal proposé. Certaines mutuelles proposent un remboursement sur ces actes hors nomenclature.
Cette agression bactérienne est la résultante d’une accumulation de bactéries sous forme de plaque dentaire au contact du sillon gingivo-dentaire : elle constitue la cause principale des maladies parodontales. Selon la nature de la plaque bactérienne et selon l’importance des mécanismes de défense de l’organisme, il existe un équilibre hôte/bactéries (santé parodontale) ou une absence d’équilibre (maladies parodontale). Il est fondamental de comprendre qu’une maladie parodontale ne concerne rarement qu’une seule dent mais plutôt un ensemble de dents sinon toute. On distingue deux grands types de maladies parodontales : - la gingivite qui se traduit par une inflammation superficielle du parodonte sans perte d’attache de la gencive sur la dent. Elle est le plus souvent liée à une augmentation de la quantité de plaque bactérienne. Elle est réversible après élimination de cet excès de plaque. Cette forme superficielle de maladie parodontale touche environ 80% de la population. - la parodontite qui se traduit par une destruction des tissus de soutien de la dent : perte d’attache de la gencive sur la dent, formation d’une poche parodontale entre la gencive et la dent, destruction de l’os alvéolaire support de la dent et d’une altération du cément qui recouvre la racine dentaire. Cette forme de maladie parodontale est irréversible : les structures perdues ne peuvent être reconstruites que dans des cas très particuliers. Les parodontites regroupent diverses formes cliniques caractérisées par un degré d’atteinte (sévère, modérée, superficielle), un type de progression (chronique ou agressive), une localisation (localisée ou généralisée) et une flore bactérienne sous gingivale particulière. 27% environ de la population française de plus de 35 ans présente une forme modérée et 15% une forme sévère. Facteurs de risque ? Le tabac, le diabète et l’hérédité sont les 3 facteurs de risque principaux des maladies parodontales. Ils augmentent le risque de développer et/ou d’aggraver une maladie parodontale. Le manque de suivi, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, le stress, l’âge, l’état de santé générale, la consommation d’alcool sont aussi des facteurs qui peuvent intervenir sur cette maladie. Comment savoir si on est malade ? Les premiers signes cliniques de cette maladie sont : l’inflammation (rougeur et augmentation de volume de la gencive), l’œdème (gonflement), la présence de plaque visible à l’œil nu et le saignement lors du brossage accompagné d’une halitose (mauvaise haleine). L’évolution se fait par une exacerbation de ces signes avec en plus la formation de tartre (qui correspond à la calcification de la plaque dentaire) et l’apparition de récessions tissulaires (déchaussement des dents). Les dents deviennent mobiles par destruction des tissus de soutien pouvant aller jusqu’à la perte définitive de la dent. Certains signes cliniques comme le saignement peuvent être masqués chez les patients qui fument, ce qui l’amène généralement à consulter à un stade plus avancé lorsque les dents commencent à bouger. Le diagnostic précis d’une maladie parodontale se fait au cabinet dentaire chez un omnipraticien ou chez un parodontologiste. Le principal outil de diagnostic est une sonde parodontale qui permet d’évaluer la formation ou non de poche parodontale (espace entre la gencive et la dent) et le cas échéant sa profondeur. Cet examen n’est pas douloureux et permet d’emblée de poser un diagnostic différentiel entre santé parodontale, gingivite et parodontite. L’examen complémentaire de choix est un bilan radiographique (bilan rétro alvéolaire) qui permet d’évaluer la perte osseuse autour des dents (en cas de parodontite). Est-ce que les maladies parodontales ont des conséquences sur l’état de santé ? De nombreuses études scientifiques mettent aujourd’hui en rapport la santé parodontale et l’état de santé générale. Ainsi une mauvaise hygiène orale pourrait constituer un facteur de risque et/ou prédictif pour les maladies ischémiques coronariennes (infarctus du myocarde). Dans le même ordre d’idée, il semble que les maladies parodontales puissent influencer le contrôle métabolique du diabète de type 2. Enfin, il semble que les femmes enceintes souffrant d’une maladie parodontale présentent un risque accru de naissance prématurée ou d’enfant de petit poids Comment soigne t-on une maladie parodontale ? La prise en charge thérapeutique d’une maladie parodontale (gingivite et parodontite) implique le praticien et le patient. En effet, la première étape fondamentale de tout traitement parodontal reste l’apprentissage par le patient d’une méthode de brossage efficace utilisant un matériel adapté à chacun (prescrit par le praticien). Le rôle du patient est déterminant dans la mesure où sa méthode de brossage permet le maintien d’un niveau réduit de plaque dentaire qui va optimiser puis pérenniser le traitement réalisé au cabinet dentaire. Dans le cadre d’une gingivite, le traitement impliquera des détartrages au dessus de la gencive afin de supprimer le tartre et la plaque dentaire. Ce traitement permettra, en association avec l’amélioration par le patient de son hygiène orale, une réduction de la quantité de bactéries et une réduction de l’inflammation des gencives. Le nombre de séance dépendra du degré de sévérité initiale de la gingivite et de la qualité de la coopération du patient. Deux à trois mois après cette phase de traitement, le praticien effectuera une ré évaluation de la qualité de l’hygiène et de la réponse de la gencive au traitement et le patient pourra alors être placé dans un programme de suivi régulier afin d’éviter les récidives. Pour les parodontites, le traitement s’organisera de la manière suivante : - prescription de matériel d’hygiène et enseignement des techniques de brossage par le praticien - détartrage au dessus et en dessous de la gencive (sous anesthésie locale) afin de réduire les bactéries présentes sous la gencive. Cette phase de traitement peut être associée à des irrigations sous gingivales d’antiseptiques. Dans certaines situations avancées, une prescription d’antibiotiques peut suivre cette phase de traitement. - ré évaluation de la réponse au traitement et de la coopération du patient - en cas de persistance de poches profondes qui saignent lors du sondage, des interventions chirurgicales peuvent être envisagées pour réduire ces poches (dans certaines situations spécifiques, au cours de ces interventions, des techniques de reformation de l’os peuvent être envisagées). - la phase d’entretien ou de maintien correspond à des rendez vous de contrôle de l’hygiène, de détartrage et de surveillance de la maladie dont la fréquence sera fonction de la sévérité initiale de la maladie et du niveau d’hygiène orale du patient. Peut-on guérir d’une maladie parodontale ? Il est tout à fait possible de guérir d’une maladie parodontale dès lors que celle-ci a été convenablement prise en charge et dans la mesure où le patient s’astreint à respecter ses rendez vous de suivi et de contrôle. Dans les cas des parodontites, si la maladie peut être stoppée, la rétraction des gencives et la perte osseuse restent irréversibles. Les traitements parodontaux sont ils remboursés par la sécurité sociale ? Seules deux séances par an de détartrage au dessus de la gencive sont remboursées par les organismes de sécurité sociale. Le reste des soins comme l’enseignement à l’hygiène orale, les détartrages sous la gencive, les irrigations d’antiseptiques sous la gencive, les analyses de la flore bactérienne, les interventions chirurgicales sont hors nomenclature. Ils ne sont donc pas pris en charge par la sécurité sociale. Il appartient donc au dentiste de fournir un devis correspondant au traitement parodontal proposé. Certaines mutuelles proposent un remboursement sur ces actes hors nomenclature.